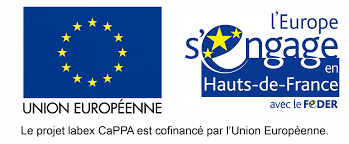WISSD
WISSD
 WISSD
WISSD
La somnolence et la fatigue cognitive sont des états de vigilance réduite qui altèrent les performances d'un conducteur ou toute personne ayant la charge de superviser des équipements critiques (contrôleurs de trafic aérien, de centrales électriques thermique, nucléaires, etc.). Elles représentent une cause majeure des accidents mortels et induisent des pertes financières importantes. Ces faits alarmants ont incité, ces 15 dernières années, le développement des techniques automatisées de surveillance du conducteur, comprenant plusieurs produits déjà disponibles dans le commerce. Cependant, ces systèmes présentent de nombreux inconvénients : ils sont basés soit sur des caméras vidéo pour superviser les yeux des conducteurs et/ou sur des réseaux de capteurs filaires encombrants ; ils ne prennent pas en compte les paramètres psychologiques, et ils ne permettent pas de récupérer et de stocker les données physiologiques de manière sécurisée pour mener des études ultérieures. Ce projet interdisciplinaire a pour objectif de développer un système de supervision en temps réel permettant de détecter des états de somnolence et d'alerter le conducteur avant son endormissement. Ce système sera basé sur des capteurs communiquant par liaison sans fil et permettant de mesurer des paramètres physiologiques liés au système nerveux. Ensuite, les valeurs prélevées sont acheminées vers un équipement (smartphone, station, etc.) pour traitement et prise de décision en prenant en compte l'état psychologique du conducteur.
La fatigue cognitive, définie comme un état de vigilance mentale réduite qui altère les performances", est une cause majeure des accidents de la route. L'administration de sécurité routière d'autoroute Américaine (NHTSA) a déclaré que chaque année la fatigue du conducteur a comme conséquence environ 1 550 morts, 71.000 blessés, et de 12,5 milliards de en pertes monétaires. La NHTSA estime que 30 millions de conducteurs s'endorment, en conduisant chaque année aboutissant à une moyenne d'environ un accident toutes les deux minutes à l’échelle nationale. Selon la Fondation nationale du sommeil américaine, 54% de conducteurs adultes déclarent avoir conduit en état de somnolence et environ 28 % d'entre eux se sont en réalité endormis au volant. En 2010, l'association américaine des automobilistes estime que 1 accident de circulation sur 6 ayant entraîné la mort, et 1 sur 8 entraînant des blessures graves, qui étaient dus à la somnolence au volant. Les études européennes indiquent des statistiques similaires: en 2011, sur 3970 accidents mortels, 732 ont eu lieu sur des lignes droites et parmi ceux-ci, 85 % étaient liés à la somnolence. 25-30% des accidents de conduite au Royaume-Uni sont associées à la somnolence. Environ 35% de conducteurs aux Pays-Bas et 70% en Espagne ont déclaré s'être endormi au volant. Des occurrences catastrophiques similaires ont été rapportées dans d'autres domaines de transport. Par exemple, l'opération de pilotage en état de fatigue a été déterminée causale dans plusieurs grands crashs d'avion (par exemple, Colgan Air Vole 3407, 2010). La fondation Américaine du sommeil estime qu'un pilote de l'air sur cinq, un opérateur de train sur six et un sur sept chauffeurs de camion provoquent des accidents en raison de la somnolence. Ces faits alarmants ont incité ces 15 dernières années le développement de techniques automatisées de surveillance de la fatigue de conducteurs. Plusieurs produits sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce (voir le tableau 1). Selon les auteurs de l'évaluation de la technique de gestion de fatigue de conducteurs, un système «idéal» devrait pouvoir, sur une base individuelle: (i) prédire la fatigue en fonction des facteurs le causant, (ii) surveiller la vigilance dans des environnements en temps réel, et (iii) intervenir lorsque les déficits potentiels sont identifiés. En outre, le système devrait avoir une fiabilité extrêmement élevée. Cependant, peu de systèmes existants satisfont à toutes ces exigences. Ainsi, l’objectif principal de notre projet est d’être force de proposition pour le développement d'un système optimal de détection en temps réel de la fatigue durant la conduite de véhicule. De plus, nous offrirons la possibilité de sauvegarder les informations physiologiques et psychologiques dans un cloud afin de les utiliser pour des travaux de recherche pour une meilleure compréhension des relations entre ces variables, et l’identification de types de conducteurs.
le présent projet a pour objectif principal l'étude, la conception et le développement d'une solution innovante, robuste pour la détection d'états de somnolence de conducteurs afin d'éviter des accidents mortels. Cette solution, basée sur des capteurs sans fils, permet de mesurer des paramètres physiologiques qui seront transférés pour prise de décision sur une unité de stockage et de traitement. La mise en œuvre d’un réseau de capteurs sans fils (RCSF) dans le cadre du présent projet implique, en amont, une analyse destinée à identifier les paramètres les plus pertinents à mesurer. Il s’agira alors aussi d’identifier les principales contraintes imposées aux capteurs à utiliser dans le cadre de ces dispositifs de mesure. La nature des paramètres à mesurer aura un impact sur le positionnement des capteurs, leur utilisation, la conception des protocoles de communication qui devront tenir compte de l’adaptation au facteur d’échelle, la tolérance aux pannes et la sécurité des données. Notre solution permet aussi le stockage sécurisé des données sur un Cloud. Ces données seront partagées de n'importe où et n'importe quand par divers acteurs (autorités de sécurité routière, responsables d'entreprises de transport, chercheurs, etc.) tout en mettant différents droits d'accès aux données récoltées. Ce projet peut être vu comme une base de données distribuée et mobile mettant à disposition de la communauté scientifique des données difficiles à obtenir pour la conduite de recherche dans le domaine de la santé en général, neurologie et sommeil en particulier.
De plus, les facteurs psychologiques du conducteur seront étudiés afin de repérer des variables de prédisposition à la conduite en état de fatigue ou de somnolence. Parmi ces facteurs, nous souhaitons étudier les processus cognitifs tels que l’attention, le contrôle, la motivation et la conscience subjective de l’état du conducteur. Ces variables seront analysées avec les contextes et conditions de conduite (expertise, représentations, trajets). En effet, différents questionnaires seront proposés aux participants, afin de relever ses habitudes et certaines dimensions de sa personnalité : questionnaires médicaux notant particulièrement des antécédents neurologiques, psychiatriques, questionnaire d’hygiène de vie et du sommeil, de consommation de substances ayant un effet sur la cognition (médicaments, alcool, autre drogue), questionnaire d’impulsivité et recherche de sensation, questionnaire d’estimation de la fatigue et de la somnolence. De plus, des évaluations des capacités de concentration, d’attention soutenue et de contrôle seront effectuées à l’aide de tests standardisés.
Ces données personnelles et cognitives seront étudiées en relations avec les données physiologiques relevées. L’un des objectifs de notre étude est d’établir des mesures entre les contrôles subjectifs des états de fatigue et de somnolence (échelle d’Epworth). En effet, la mésestimation de l’état de fatigue de la personne peut conduire à des prises de risque. Ainsi, cette approche se situe à un niveau plus individuel afin de déterminer les tendances d’un conducteur à prendre des risques. Une des questions est celle de la mésestimation de la plainte de fatigue et de ces conséquences dans les sociétés contemporaines. Alors que les sociologues soulignent l’accélération des rythmes de vie et les problèmes de privation de sommeil inhérents à la société moderne, la plainte de fatigue est néanmoins peu prise en compte. Elle peut cependant être à l’origine de nombreux troubles fonctionnels (céphalées, douleurs, crampes…) et donner lieu à des comportements à risque. L’évaluation personnalisée et contextualisée de la prise de risque permettrait de la mettre en relation les événements initiateurs des accidents. De plus, elle pourrait contribuer à apprécier l’impact des aides à la conduite sur le comportement du conducteur.
Cette étude peut être appliquée en accidentologie dans le cadre notamment des études détaillées d’accidents. Elle peut être également utilisée dans les études sur simulateur ou dans le cadre de recherche sur la modélisation des comportements des conducteurs permettant d’appréhender de façon plus fine leurs comportements au volant. Cette étude est utile pour mieux cibler des campagnes de prévention, pour les futurs développements d’aide à la conduite et pour le partage de conduite des futurs véhicules autonomes.
C’est la base du partenariat mis en œuvre entre le laboratoire Heudiasyc (UTC), l'UMR Inserm 1105 Groupe de Recherches sur l'Analyse Multimodale de la Fonction Cérébrale, le CRP-CPO EA7273 (UPJV), et l'équipe UPSV du CHU d'Amiens).